
Le 29 septembre 2015, Edward Snowden a lancé son compte Twitter avec le tweet référent de Verizon, ‘Pouvez-vous m’entendre maintenant’ [1] En un jour, le message avait été favorisé et retweeté plus de 100 000 fois et la National Security Agency Le lanceur d’alerte (NSA) a gagné plus d’un million de followers. [2] Depuis lors, Snowden a utilisé la plate-forme pour plaider en faveur d’une législation plus stricte contre la surveillance de masse et a averti les utilisateurs de crypter leurs données. Cependant, tout au long de son mandat sur Twitter, il n’a suivi qu’un seul compte: la NSA elle-même.
La décision de suivre ostensiblement une agence qui suit secrètement les pratiques numériques de plus d’un milliard de personnes dans le monde entier est à la fois une blague provocatrice et une reconnaissance dégringolante des asymétries frustrantes de la surveillance gouvernementale. Le choix de Snowden d’utiliser les médias sociaux, l’un des épicentres de la collecte de données en vrac, pour avertir des menaces de la collecte de données en vrac présente une autre dualité révélatrice, par conséquent, son flux Twitter résume certains des débats qui ont enrichi les dialogues. En plus de la formulation souvent citée par Foucault du «panopticisme» [3], elle évoque la notion de «synopticisme» de Thomas Mathiesen, «le synopsis de beaucoup», [4] et l’idée d’Anders Albrechtslund. de la «surveillance participative», l’interaction volontaire entre observateurs qui peut être ludique et galvanisante. [5] Le fait que ces modalités semblent fonctionner simultanément dans ce cas témoigne des défis de l’analyse de la surveillance à l’ère des capacités de surveillance intensément composées.
Chargé de décrire les dimensions d’un tel phénomène multi-scalaire, ce numéro de la revue Media Fields suggère de se tourner vers la spatialité comme un point d’entrée incontournable. Pour cartographier les cartographies inégales du ciblage et de la gestion, les chercheurs peuvent se concentrer sur des sites particuliers et interroger leur interaction avec des technologies, des subjectivités et des processus de médiation spécifiques. De plus, nous pouvons considérer les espaces incarnés, en particulier lorsque les logiques informatiques assignent des risques différentiels et exercent une force d’intensification sur les individus et les populations précaires. Ainsi, afin de reconnaître les valences multiples de la surveillance, nous devrions zoomer tactiquement dans et hors de diverses gammes et perspectives comme les dispositifs optiques qui enregistrent nos mouvements.
En utilisant cette approche multisituée et polyvocale, nous pouvons également réfléchir au concept des «états de surveillance». Ce terme désigne les superpositions complexes de précédents historiques de programmes de surveillance de masse, de surveillance mise en œuvre au nom de la sécurité nationale et de la territorialisation, les conditions affectives de vie sous surveillance et de surveillance comme capacité dynamique dans une perpétuelle forme de flux. En même temps, il parle aussi de l’état fluide des études de surveillance elle-même, nous rappelant que les discours académiques sont eux-mêmes historiquement situés et sujets à leurs propres opinions et angles morts. Par conséquent, pour examiner l’état actuel de ce domaine, cette question s’appuie à la fois sur une longue lignée théorique et identifie des formations changeantes qui justifient une enquête plus approfondie. Leurs contributions offrent des perspectives uniques sur ces sujets, mais aussi des dialogues qui se photo de coque de samsung chevauchent et soulèvent des questions complémentaires. Les deux analysent le capteur IMSI, une technologie largement inconsidérée qui augmente les nombreux problèmes autour de l’interception cellulaire. Parce que ce puissant appareil recueille des données et écoute les conversations téléphoniques à un niveau de masse, il nous rappelle également que les études de surveillance doivent dépasser le domaine de la visualisation. Dans sa contribution, Parcs fournit un aperçu historique de la fabrication et de l’adoption du capteur IMSI au niveau mondial. Elle souligne également certains des aspects troublants que ses usages suggèrent, tels que la logique réductrice de la défense «rien à cacher» et le paternalisme des justifications libérales occidentales de la surveillance. Farman examine ce dispositif d’interception comme un tremplin pour développer son concept de «surveillance à partir du milieu». Pour lui, ce point de vue est plus approprié pour aborder la matérialité des technologies d’intervention asynchrones et leurs effets médiateurs. Il soutient cet argument en se penchant également sur une technologie de communication antécédente, la lettre délivrée, et sa censure par les officiers de l’armée américaine pendant la Première Guerre mondiale.
Andrea Miller et Alexander Champlin prolongent les discussions sur la surveillance dans les systèmes de militarisation. Pour eux, c’est un instrument qui peut calcifier les relations de pouvoir existantes, mais qui peut aussi révéler certaines des fissures et des échecs des institutions dominantes. S’appuyant sur les frontières de plus en plus nébuleuses entre espaces militaires et civils, Champlin décrit le «swatting», un genre de farce dans lequel des joueurs anonymes inventent des situations d’urgence pour envoyer des équipes de SWAT vivre en direct les maisons des joueurs. produit une forme interactive de médias numériques qui peut être mieux comprise à travers les termes de la banalité et du jeu. L’essai d’Andrea Miller analyse les photographies d’Abou Ghraib du corps du détenu fantôme Manadel al Jamadi pour examiner la biopolitique des cadavres dans la guerre. Terreur: Pour Miller, le dossier photographique de Jamadi souligne l’incapacité de l’Etat à exercer un contrôle datalogique complet sur les récits des morts et son impulsion nécropolitique à circonscrire certaines populations au domaine de l’insaisissable.
Les questions de (in) visibilité et de race figurent également au premier rang des articles de Simone Browne et Anirban Gupta Nigam: compte tenu des énormes niveaux de violence et de discrimination dont font l’objet les systèmes racistes contre les groupes marginalisés, la race est un domaine particulièrement Comme l’explique Browne dans son livre Dark Matters, les applications historiques de la surveillance contre les Afro-Américains n’ont pas été pleinement reconnues dans la plupart des théories existantes de la surveillance, et discutent d’une application de test d’ascendance qui crée de nouvelles opportunités d’exclusion numérique. Browne souligne l’émergence d’un nouveau champ de bataille génétique entre des dispositifs d’authentification ADN de plus en plus sophistiqués et des stratégies de falsification, tandis qu’Anirban Gupta Nigam s’intéresse aux fantasmes culturels de rendre visible la noirceur et théorise noirceur qui prend la forme de sol ou de milieu qui se produit avant publi c conscience. En ce sens, la noirceur est une force constitutive dans la production de rapports de pouvoir et dans la façon dont les observateurs imaginent les environnements sociaux qu’ils rencontrent.
Mark Andrejevic, Scott Sundvall et Gavin Smith considèrent également les imaginaires de l’engagement des utilisateurs, en se concentrant sur les rôles que le désir et le soi jouent dans les expériences contemporaines d’observation et de révélation. Notant les limites de dissipation entre la surveillance et l’auto-exposition, Andrejevic discute des pulsions scopiques à travers les théories de Sigmund Freud et Jacques Lacan. Son approche psychanalytique l’amène à poser une «surveillance totale» permise par l’oblitération de la subjectivité en d’autres termes, l’oblitération du manque qui génère le désir coque de telephone personalisable en premier lieu. Sundvall se concentre également sur les inclinations psychiques à travers son terme «désirant la surveillance», ou le désir de voir et d’être vu. Il utilise l’idée de Gregory Ulmer de «l’électricité» pour analyser les formations culturelles contemporaines qui désirent la surveillance et la négociation.Pendant ce temps, Smith cherche à expliquer la réponse publique limitée aux révélations d’Edward Snowden et la réticence des utilisateurs à modifier les pratiques numériques. Il propose que les «structures d’accompagnement» quotidiennes routinisent aujourd’hui les processus culturels de performance numérique, de visibilité et de surveillance et, par conséquent, ont fait de la résistance généralisée à la surveillance de masse une perspective improbable.
Dans le même ordre d’idées, Thomas Stubblefield, Beth Capper et Michael Litwack fournissent des moyens de compliquer et de reconcevoir les notions familières de résistance. Ils le font en positionnant la résistance à la fois en réponse et grâce à des mécanismes de surveillance. Stubblefield juxtapose deux cas de disparition de la surveillance: l’auto-effacement performatif de Peter Bergmann et les évasions de Christopher Thomas Knight qui durent depuis des décennies, «l’Ermite de North Pond». Stubblefield compare le croisement visuel et géographique des seuils de Bergmann à l’espace délimité de Knight, pour explorer comment la sphère numérique peut être radicalement cooptée. Dans leur article, Capper et Litwack parlent de l’organisation féministe Hollaback! encadre son application smartphone comme une défense contre le harcèlement de rue basé sur le genre. Plutôt que de faire l’éloge de cette stratégie en tant que moyen de mobiliser les femmes, ils discutent de la manière dont Hollaback! Est indispensable pour cartographier les zones urbaines en harmonie avec les régimes carcéraux et racialisés de la surveillance de l’État. catégorie uniformément émancipatrice, mais qui nécessite aussi ses propres critiques et contre-résistances.
En rassemblant tous ces articles dans un seul espace numérique, cette question met en évidence certaines des intersections génératrices dans les conversations sur la surveillance qui se produisent dans les disciplines, les image de coque d’iphone contextes et les objets d’étude. Il repense les façons dont nous situons nos enquêtes et indique de nouvelles façons d’imaginer de futures interventions et critiques. En fin de compte, ce faisant, ce numéro espère que l’état actuel des études de surveillance est aussi dynamique, réactif et multidimensionnel que les espaces et les états de surveillance qu’il étudie..
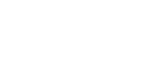
Leave a Reply